Article de Sébastien Scherr
Vers les cimes
À chaque fois que l’on voit une pièce d’Ibsen, on se dit : « Ah ! C’est vraiment celle-là, sa meilleure ! » C’est particulièrement vrai si elle est bien jouée et bien montée. Stéphane Braunschweig réussit ici un coup de maître avec ce Canard sauvage. Le texte, les personnages, la situation tout y est mis en valeur. Les comédiens sont tous très bien, pas une fausse note, pas un qui soit au-dessous des autres, signe d’une excellente direction d’acteur en même temps que d’une distribution impeccable.
 © Elisabeth Carrechio
© Elisabeth Carrechio
Ce qui frappe en premier à l’ouverture du spectacle, c’est la scénographie, avec cet immense mur imposant en avant-scène qui laisse un minuscule espace de jeu aux comédiens au premier acte. Il représente le devant écrasant de la maison de Werle. Bientôt, ce mur se transformera en écran géant où sera projeté le visage de Werle en gros plan, avant de laisser place au deuxième acte à la maison des Ekdal. Ce personnage du père tout puissant qui hante toutes les pensées du tout petit Gregers Werle sera le moteur de toute l’intrigue. Et puis, il faut souligner le rythme de la pièce. Bien qu’assez longue et sans entracte, elle ne souffre d’aucun temps mort, grâce notamment à une prodigieuse ingéniosité dans la mise en espace choisie par le metteur en scène. La maison des Ekdal est une sorte de cabane en bois surélevée sur un dispositif mobile. Ce « mobile home » s’ouvre en fond scène sur une forêt de pins, dont on n’aperçoit que les cimes, symbolisant le dernier résidu de nature préservé par le vieux chasseur Ekdal dans son grenier. Cette mise en abîme est renforcée par une idée très efficace : la maison des Ekdal chavire littéralement sous nos yeux et imperceptiblement à mesure que la famille bascule dans son irrévocable gouffre. Et cette ouverture sur un extérieur-intérieur doublée d’un basculement dans le vide provoque un vertige sidérant. On se croirait dans les décors de Dali composés pour la « maison du docteur Edwards ». Tout devient étrange en même temps que familier. Et l’intrigue progressera tranquillement avant que le spectateur n’ait compris où elle le mènerait.
 © Elisabeth Carrechio
© Elisabeth Carrechio
Une fois de plus, Ibsen s’attaque à la confrontation de l’idéal et du réel. Et le réel l’emporte toujours à la fin, brisant les rêves les plus fous, les illusions les plus candides. L’anti- héros enferré dans ses fantasmes se révèlera incapable d’accepter que la vie est plus apte au compromis, à l’imperfection et cependant plus adaptable que le plan le plus parfait. Elle fera voler en éclat tous ses schémas, tous ses dogmes. Et le petit garçon ou la petite fille qui n’a pas grandi, incrédule devant ce meccano aux lois changeantes, échouera à coup sûr à prévoir les mouvements des autres humains.
Mais alors que Hedda, Sollness, Nora ou le docteur Stockmann scellent leur propre destin, Gregers va ici entraîner son ami Hjalmar Ekdal et sa famille dans son schéma destructeur. On retrouve dans le Canard sauvage un peu des Revenants avec la hantise de la figure d’un père auteur d’une faute originelle, et un peu des Piliers de la société ou de Hedda Gabler avec cette obsession du « qu’en dira-t-on ». L’honneur, la dignité, la façade sont mis au pilori avec cette écriture subtile d’Ibsen qui ne dénonce jamais directement ce qu’il attaque, mais toujours en négatif, en contre-jour, par les non-dits amenés peu à peu autour des situations et qui en disent tellement sur le comportement du héros.
Le féminisme tient toujours une place prépondérante : le personnage de l’épouse, femme de tête et aimant son pauvre mari avec tous ses défauts, anticipant toujours longtemps avant lui où le mènera sa lâcheté ; celui de la fille dévouée capable du plus grand sacrifice pour prouver son amour inconditionnel à son aveugle de papa embourbé dans sa vanité ; celui encore de l’ambitieuse Madame Sorby lucide sur ses propres motivations comme sur les limites imposées par la condition féminine de son temps : toutes sont plus pragmatiques que les hommes. Eux sont des incapables : le pauvre Hjalmar Ekdal empêtré dans l’idée qu’il se fait de lui-même, son vieux père alcoolique fuyant délibérément le réel, l’ami médecin Reilling au cynisme aggravé, seule bouée pour surnager dans une existence morne, jusqu’au petit Gregers, apprenti sorcier qui, jouant au bonheur des autres, n’admettra jamais l’erreur fondamentale de son raisonnement : le mensonge n’est pas toujours nocif, il est parfois la condition même du bonheur.
Le canard sauvage
De Henrik Ibsen
Traduction Eloi Recoing
Adaptation, mise en scène et scénographie Stéphane Braunschweig
Collaboration artistique Anne-Françoise Benhamou
Collaboration à la scénographie Alexandre de Dardel
Costumes Thibault Vancraenenbroeck
Lumières Marion Hewlett
Son Xavier Jacquot
Assistante à la mise en scène Pauline Ringeade
Assistante costumes Isabelle Flosi
Maquillage et coiffures Karine Guillem
Stagiaire David Belaga
Avec Suzanne Aubert, Christophe Brault, Rodolphe Congé, Claude Duparfait, Charlie Nelson, Thierry Paret, Chloé Réjon, Anne-Laure Tondu, et la participation de Jean-Marie Winling
Du 6 au 14 janvier 2016
Théâtre de la Colline
15 rue Malte-Brun
75020 Paris
www.colline.fr


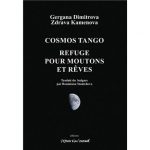
![[Festo Pitcho Avignon] « FESTIVAL DE SPECTACLES VIVANTS POUR PUBLICS JEUNES DU 6 AU 24 AVRIL 2024 », Les enfants en fête](https://theatreactu.com/wp-content/uploads/2024/04/Festo-Pitcho-Totem-6-4-2024-Cie-Caramantran-150x150.webp)